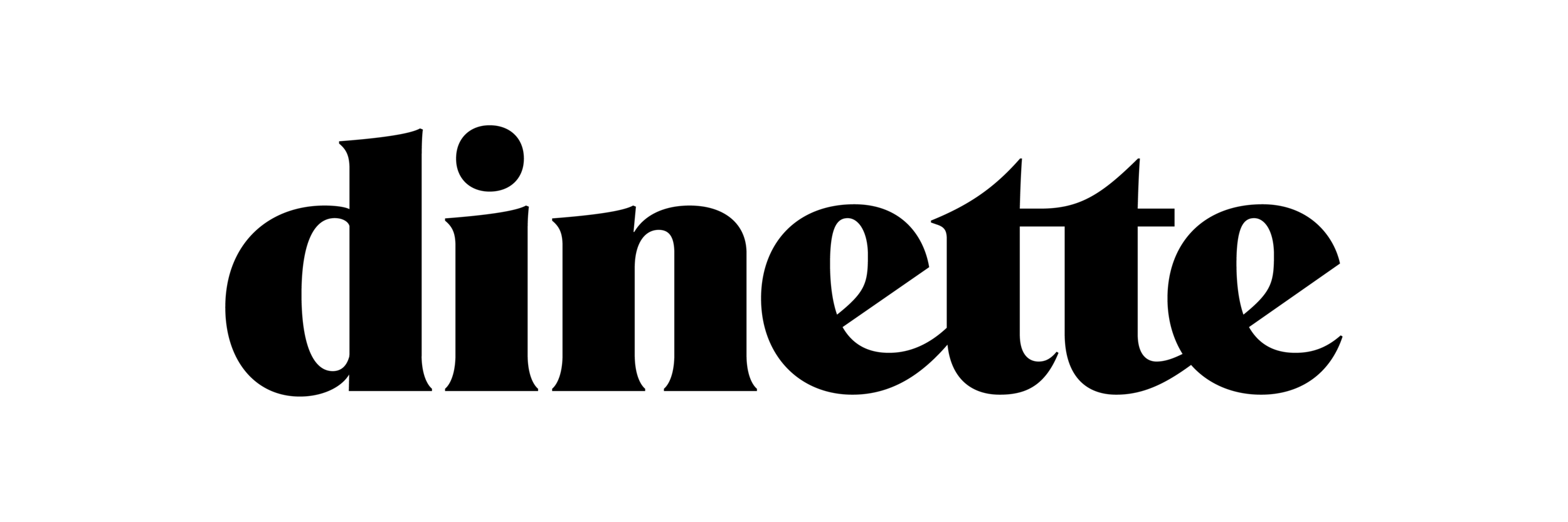Défaire ses noeuds
Je suis coupable d’aller partout en voiture. J’habite à Montréal, à quelques coups de pédale ou deux stations de métro du centre-ville, je sais. Je bois mon café dans une tasse réutilisable et je n’achète pas d’eau en bouteille, j’essaie.
Je ne suis pas insensible face à l’enjeu écologique de la conduite en solo, je suis hypersensible face à… tout. La proximité humaine commandée par les voyages en autobus de la STM raccourcit ma respiration, me serre la gorge. Je suffoque, je panique, je veux débarquer, je veux ma voiture – c’est mon refuge. L’instant où, à la fin de la journée, je referme la porte de chez moi pour me retrouver seule dans le silence, c’est mon favori…
Jusqu’à ce que se glisse sous cette même porte un sentiment de solitude qui s’agrippe à mes jambes et trace son chemin jusqu’à mon ventre pour y former un noeud… Cet inconfort, c’est le grand paradoxe de la vie urbaine – des milliers d’âmes qui se bousculent, mais qui demeurent anonymes, de l’étranger dans la file au café, jusqu’au voisin, dont on ne connaît que les habitudes télévisuelles : les murs sont faits de papier de soie.
Quitter l’île de Montréal, j’y ai rêvé souvent. M’exiler là où « tout le monde se connaît » pour vrai. Leur emprunter du lait que je ne bois pas, juste pour dire bonjour.
Pour le moment, je pars pour les Îles-de-la-Madeleine.
Trois jours aux Îles avec Math pour comprendre ce qui cause le changement dans l’œil de ceux qui en reviennent, comme s’ils avaient mis la main sur le lot d’une chasse au trésor.
À notre sortie de l’aéroport, le vent, personnage principal des Îles-de-la-Madeleine, nous accueille avec toute sa force. Les Îles n’ont rien à cacher; dès nos premiers kilomètres sur leurs routes, elles nous dévoilent leurs dunes sablonneuses, leurs larges plages, leur ciel ambivalent, leurs champs verts et dorés. Devant nous, tellement d’éléments, mais honnêtement, tout ce que mon cerveau accepte de percevoir, c’est le grand vide, le grand rien, et à nouveau, j’ai un nœud dans le ventre.
C’est Émile, Madelinot et vieil ami d’école de Mathieu, aujourd’hui à la tête de la salle de spectacles Au Vieux Treuil, qui m’a aidée à le dénouer en mettant le doigt dessus : « T’as le vertige horizontal », qu’il me dit, sourire en coin. Avec une pointe de tristesse, mais d’autodérision aussi, je constate que ma vision a besoin d’ajustement et ma tête d’un peu de temps pour encaisser la grandeur de l’horizon.
On a rencontré Émile au Café de la Grave, abri mythique pour les Madelinots et idéal pour les touristes en quête de connexion avec l’essence même des Îles-de-la-Madeleine. Certains se souviennent de l’époque où les pêcheurs s’aggloméraient au comptoir pour raconter leurs aventures, d’autres vous diront qu’il fut un temps où l’on s’y réfugiait pour se réchauffer les mains près du poêle à bois, disparu depuis. Mes souvenirs à moi seront teintés des sourires réconfortants et de l’enthousiasme entrepreneurial de Marie- Josée et Marie-Frédérique, deux grandes amies aujourd’hui partenaires d’affaires avec leurs mamans, Micheline et Nathalie. Quatre femmes pour succéder aux quatre hommes qui assuraient auparavant la gestion du Café, résidence secondaire de tous – Claude, Henri, Jean-Marc et Fernand. Je m’attache à l’histoire comme je m’attache à tout le monde ici, en quatre secondes. Je ressors du café avec une tasse souvenir. Une fan.
Les grands espaces et l’air salin font leur travail et le rythme cardiaque de Mathieu et moi ralentit, notre pas aussi. « Ça doit être cool, chiller », laisse tomber Mathieu en conduisant. Ça me fait rire. On est ici pour réapprendre comment faire, je crois.
Tout au long de notre visite, un ange, Léa, veille sur notre bonheur en coloriant notre séjour de rencontres et de paysages. Son travail s’étire jusqu’à partager son quotidien et ses amies, avec nous. Ce sont cinq filles armées de chaudrons de moules, de salades et de pains frais que nous avons regardé entrer dans notre chalet avec aisance. Mathieu me jette un regard amusé alors qu’on accueille Léa, Laurence, Marie-Pier, Andréanne et Tanya, chez nous. Et en une soirée avec elles… J’ai tout compris.
Un fascinant mélange de fougue et de douceur vit en chacune d’elles, à l’image de l’océan qui se déchaîne, puis se rendort à quelques pieds de nous. En discutant avec elles et en me laissant bercer par la voix d’Andréanne qui se fond à celle de Laurence qui multiplie les hits en jouant de la guitare, mon cœur prend de l’expansion. Ici, les âmes sont libres et les tracas partent au vent comme nos casquettes. C’est donc ça qui a changé dans l’œil de tous ceux qui reviennent des Îles; soudainement, un laisser- aller sincère, un bonheur facile retrouvé.
C’est avec ce nouveau cœur grand ouvert que les explorations se sont poursuivies. On a visité l’Île d’Entrée, qui, je suis persuadée, est née d’un rêve de pêcheur qui souhaitait marier le vert de l’Irlande aux falaises orangées du Portugal. On a rencontré l’incomparable Ben à Ben, expression familière signifiant « le fils de… », dans son Fumoir d’Antan, où l’odeur de poisson fumé s’est collée à nos chandails de laine pendant des jours et des jours. On a mangé, mangé, et encore mangé chez Marie-Josée, qui a cuisiné tous les plats typiques des Îles : des zéplans (éperlans) au pot en pot (prononcé potte-en-potte) en passant par les galettes de morue et l’effiloché de loup marin, juste pour nous recevoir à sa table dans sa maison ancestrale, entourée de sa famille et de ses amis. On a pris des photos, on a remarqué l’absence de clôtures, on a trouvé ça beau.
Aux Îles, on a revécu nos seize ans, on a fait battre nos jambes vite juste pour le plaisir de courir sans objectif et on a bu, des récits, des bières, des cafés… Parce qu’on a pris le temps de le faire.
Tout ce qu’on y a vu et ressenti, on l’a mis dans nos valises, et on l’a ramené à la maison pour application future. L’absence de clôtures, la nature comme unique guide, l’intimité dans l’immensité, la promiscuité désirée, c’est enviable, enivrant.
Le matin de notre départ, on est parti se balader en kayak sur l’océan avec nos amies. Nos amies qui, il y a 72 heures, étaient encore des inconnues. Pourtant, c’est avec la gorge serrée d’émotions que je leur ai dit au revoir, emplie d’un sentiment semblable à celui qui nous envahit quand on quitte les amies du camp de vacances, après un été d’aventures, de premières amours et de guimauves grillées.
Texte
Marie-Philippe Jean
Photos
Mathieu Lachapelle