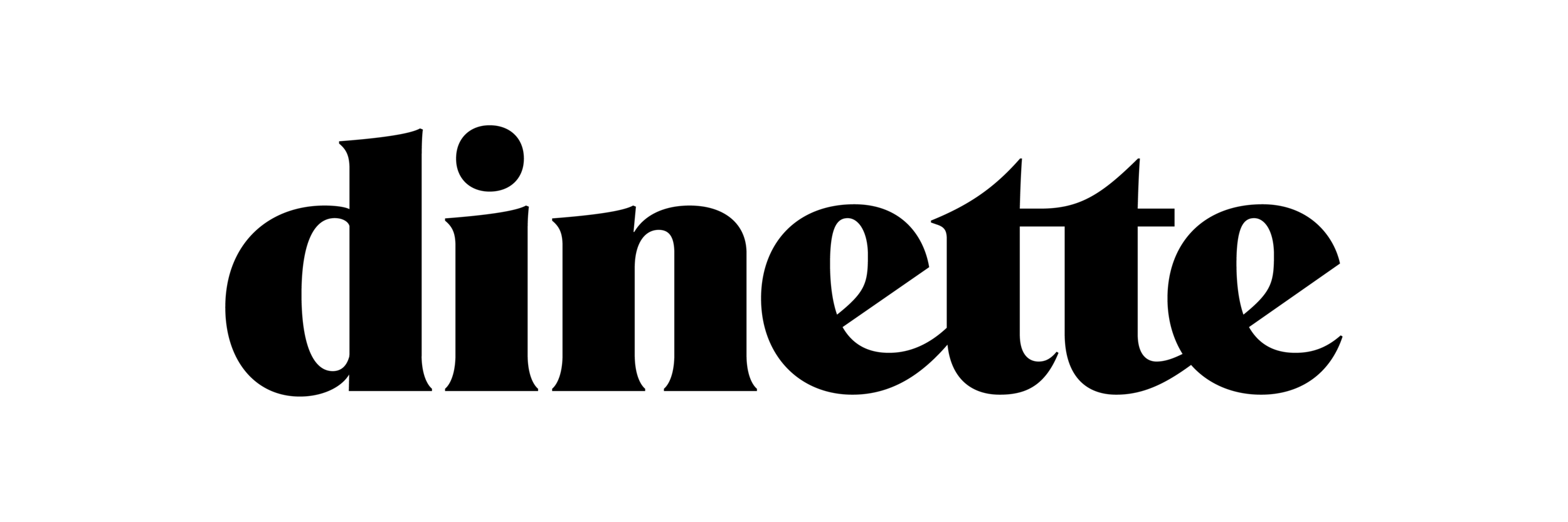Le test de l’Île Verte
Dans mon deux et demie montréalais, sur une étagère où cohabitent plantes mortes-vivantes et toiles à demi achevées, se trouve une de mes plus précieuses possessions : un bocal en verre qui renferme un été de souvenirs. À l’intérieur, une douzaine de coquilles d’oursins, cueillies sur la plage, à l’Île Verte, où j’ai passé mon été 2015 à titre de gardienne de phare.
C’était l’oncle de mon amie Cynthia qui nous avait trouvé ce job d’été, étant lui-même un acteur important dans la conservation du patrimoine marin québécois. Comme la municipalité cherchait également une troisième personne pour s’occuper du musée local, deux de nos amis avaient joué à pile ou face pour savoir qui se joindrait à l’aventure, et c’est Philippe qui l’avait remporté.
Nous avions débarqué sur l’île pas mal amochés. La fin de session universitaire nous avait laissés épuisés et pas du tout ravis – rien qu’un café-crème de dépanneur aurait pu faire passer. Les attentes étaient très hautes pour notre séjour, à l’échelle de notre fatigue du moins, et sur cette île où le seul bon réseau Internet accessible était au quai, nous avions hâte d’être déconnectés.
Une ancienne école reconvertie en musée nous servait d’habitation. Un havre où l’eau laissait sur la peau un parfum de sandwich aux œufs et où notre intimité se comptait en une quinzaine de pieds carrés. Dans l’entrée, un authentique crâne humain ponctuait le début de la visite racontant les balbutiements de la municipalité et ne manquait pas de me terrifier si j’avais le malheur de devoir utiliser la salle de bain la nuit.
J’avais naïvement espéré passer mes journées de congé cocktail à la main, vêtue d’une robe légère à arpenter les côtes de l’Île Verte à pied – pourquoi pas. Mais la météo en a voulu autrement et a su tuer ces fantasmes illico; le brouillard à couper au couteau et la pluie glacée qui a battu l’île pendant nos premiers jours ont vite fait de noyer mes espoirs. Roulée en boule dans le grenier humide qui nous servait de chambre, je me sentais prisonnière, incapable d’échapper à ma tristesse. J’avais quitté Montréal le cœur en miettes, dévastée par une rupture qui n’en finissait plus de finir. Philippe était dans un état similaire, pour des raisons semblables. Nous sommes arrivés assez vite à la conclusion que d’essayer de fuir notre peine sur une île lui donnait en fait toutes les occasions de réussir à nous rattraper. Le soir, sur les pierres glissantes près du phare, nous passions de longues heures à décortiquer nos malheurs, à mettre des mots sur nos naufrages.
Au bout d’un mois sur les lieux, de petits miracles avaient commencé à prendre vie autour de nous. Il faisait beau de façon constante. Même si l’image d’un phare sous la pluie et de vagues fracassantes sur la côte n’est pas dépourvue d’une beauté dramatique, il n’y a rien comme un ciel bleu pour vous faire sentir con d’être triste. Pour la première fois, la beauté stupéfiante de l’île brillait au soleil et donnait envie d’aller s’y perdre. Avec les conseils de l’oncle de Cynthia et la patience de ceux qui n’ont rien de mieux à faire, nous nous sommes lancés dans une exploration/documentation de toute partie de l’île n’étant pas privée. C’est lors de ces longues journées que j’ai pris l’habitude de dessiner le paysage qui s’étalait devant mes yeux, faute d’avoir un bon appareil photo.
Puis nous nous sommes liés d’amitié avec les aubergistes qui habitaient au phare. Un couple absolument lumineux qui avait le double de notre âge, mais une âme bien plus jeune que la nôtre. Quand j’arrivais le matin pour mon quart de travail, après avoir dévalé l’impressionnante côte en gravelle qui a laissé des traces sur mes genoux, Blandine m’attendait avec un plat de délicieuses crêpes et, si j’étais chanceuse, un drame local à me mettre sous la dent. À l’auberge, une apparition du chat de Jocelyn, Bobino, créait autant de remous qu’une queue de rorqual à l’horizon, et personne n’était à l’abri de la redoutable répartie des tourtereaux. Il planait en permanence dans l’air une odeur de café frais et la promesse d’une bonne conversation.
Le dernier quart s’est opéré naturellement. Mais lorsque nous avons réalisé à quelle vitesse le temps était passé et combien peu de temps il restait à notre séjour, chaque soirée est devenue lourde d’occasions, comme chargée d’un potentiel d’aventure. C’est de cette façon que nous nous sommes ramassés coincés dans un barachois au petit matin, que nous avons nagé sous les étoiles dans un banc de plancton bioluminescent et que nous avons écouté le concert en direct des loups-marins sur la grève.
Quand est venu le temps de partir, nous avons longuement dressé le bilan de notre séjour insulaire. Nous avons passé en revue les soirées arrosées, celles à pleurer, les anecdotes aussi savoureuses que le poisson fumé local et les maintes leçons apprises. Par exemple que la commande d’épicerie par bateau comporte son lot de hasard, et que la taille d’une île n’est pas proportionnelle à la quantité de bisbille entre ses habitants.
Que la valeur de ces deux mois passés sur notre caillou se comptait surtout en conversations à très peu de mots, où le silence rendait les confessions vaillantes et les éclats de rire brillants. Et que la nature, les amitiés précieuses et le temps aident à guérir beaucoup plus de maux qu’on ne pourrait le croire. Je pense que nous avons surtout compris bien plus tard, une fois revenus en ville, tout le côté précieux de cet été-là.
Notre dernier jour sur l’Île Verte, je suis allée me promener sur ma plage préférée, près du Gros-Cap. C’est là que j’ai trouvé ma collection de coquilles d’oursins, aussi appelées « tests d’oursins ». Alors qu’un peu plus tôt dans l’été je m’y serais sûrement comparée en déplorant le vide que je ressentais à l’intérieur, ce jour-là j’y voyais autre chose. Je regardais la trace d’une vie transformée en bijou par le lavage des marées, et j’ai trouvé ça beau. J’ai mis ces coquilles dans mon sac avec beaucoup de soin et j’ai marché vers le fleuve pour aller me laisser bercer par les vagues, cycle délicat.